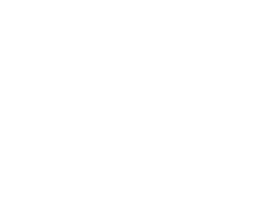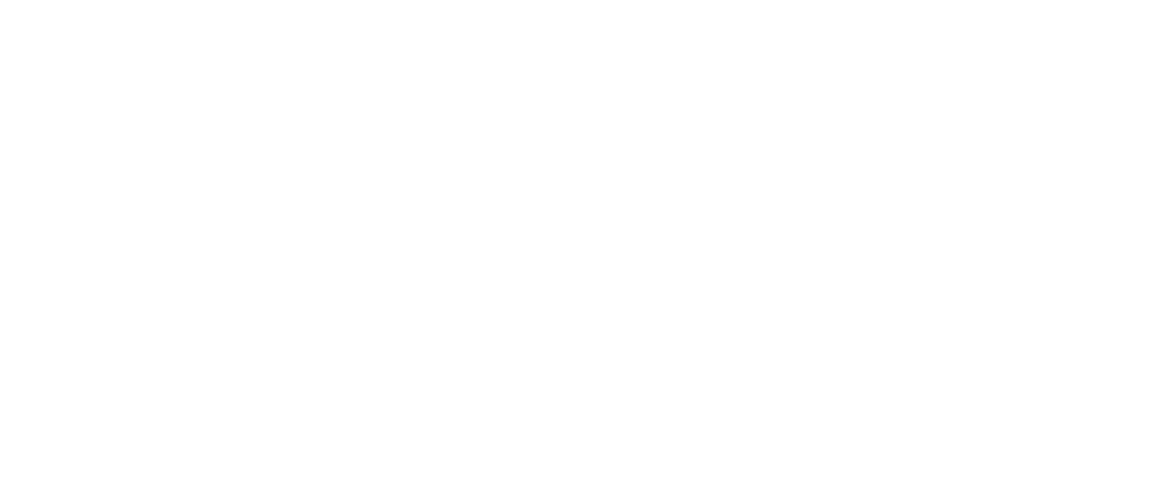
CULTURES RENTABLES ET EN CROISSANCE : PISTACHES
Introduction
Une culture rentable est définie comme une culture qui permet de récupérer l’investissement initial dans un délai relativement court ou le plus rapidement possible. Il est également défini comme celui pour lequel les bénéfices de sa vente sont bien supérieurs à l’investissement à réaliser. Dans cette publication, nous analyserons certaines des cultures considérées comme les plus rentables pour 2020, notamment la pistache, l’amande, l’avocat, la mangue, la myrtille, le houblon, l’arnica, le souci et la lavande. Pour chacun d’entre eux, on établira leurs besoins agronomiques, car tous ne se développent pas de manière adéquate dans tous les types de sol et dans tous les types de conditions climatiques.
En résumé, le lancement de l’une des cultures susmentionnées doit tenir compte d’une série de facteurs conditionnants, c’est-à-dire d’une étude approfondie des caractéristiques de la zone. C’est un élément clé, car la production et, par conséquent, les revenus en dépendront. La situation actuelle du marché doit également être analysée, ainsi que les perspectives d’avenir et le prix de vente du produit. Enfin, il est conseillé de calculer les coûts estimés, car la différence entre ceux-ci et les bénéfices en fera une culture rentable ou non.
Pistache
La culture de la pistache est actuellement en hausse sur le marché, on peut donc établir, sans aucun doute, qu’il s’agit d’une culture rentable aujourd’hui. Il faut toutefois garder à l’esprit que le marché est très variable dans le temps, de sorte que sa rentabilité ne peut être garantie qu’à court terme. C’est une culture relativement simple, car ses besoins ne sont pas très nombreux, et elle peut pousser dans pratiquement n’importe quel type de sol, à condition de garantir un bon drainage. En outre, sa plage de tolérance aux températures est très large, puisqu’elle supporte jusqu’à 50 ºC en été et des hivers où les températures atteignent -30 ºC. Le principal inconvénient de cette culture est qu’elle n’atteint pas un niveau de production stable avant 3 à 7 ans, selon que l’on plante des porte-greffes greffés ou non.
- Caractéristiques générales
Le pistachier (Pistacia vera) est un arbre à feuilles caduques, généralement de petite taille, bien qu’il puisse atteindre une hauteur de 7 à 10 mètres, selon la variété cultivée. L’écorce est rugueuse avec des tons grisâtres et présente des ramifications abondantes, ainsi qu’une couronne dense. Son système racinaire est capable d’atteindre de grandes profondeurs, grâce à une racine pivotante très développée, ce qui en fait une espèce capable de pousser dans des climats plus secs.
C’est un arbre dioïque, c’est-à-dire qu’il possède des individus mâles et femelles, de sorte que les fleurs mâles et femelles se trouvent sur des tiges différentes. La différenciation florale a lieu l’année précédant la floraison et les arbres mâles commencent généralement à fleurir avant les arbres femelles.
Il possède deux types de bourgeons, les bourgeons dits végétatifs ou bourgeons à bois et les bourgeons à fleurs. Dans les premiers stades de développement, tous les bourgeons de l’arbre sont végétatifs, tandis que plus tard, les bourgeons floraux prédominent, ne laissant qu’un ou deux bourgeons de bois sur les nouvelles pousses. Les bourgeons à bois apparaissent après la floraison, c’est-à-dire vers avril, et sont plus petits que les bourgeons à fruits. Parmi ceux-ci, le plus grand est le bourgeon terminal, qui est plus épais et plus précoce, en raison de la dominance apicale. Les boutons floraux sont disposés dans les aisselles, un par aisselle.
La pollinisation, qui commence lorsque les grains de pollen atteignent le stigmate, et la fécondation sont essentielles pour la formation et la nouaison des fruits. La pollinisation est anémophile, ce qui signifie que le pollen est transféré par le vent. La déhiscence du fruit est une caractéristique très particulière de cette espèce, qui correspond à l’ouverture de la suture qui unit les deux valves du fruit, ce qui facilite son ouverture par le consommateur, s’il est commercialisé avec la peau.
- Conditions environnementales
Compte tenu de ses caractéristiques, décrites précédemment, notamment en raison de son système racinaire, le pistachier nécessite des sols profonds, c’est-à-dire des sols d’une épaisseur d’au moins 2 mètres de terre altérée et de peu de terre non compactée. Il pousse bien dans les sols alcalins avec un pH supérieur à 7,5 et limoneux, c’est-à-dire avec une texture de loam à gros grains ou sableux.
En ce qui concerne les températures, il a été établi que c’est une espèce typique des étés longs, chauds et secs, malgré lesquels elle a besoin de 700 à 2000 heures de repos hivernal. Cela implique que pendant environ 30 à 40 jours consécutifs, la température moyenne ne doit pas dépasser 7,2 °C. Si la dormance hivernale n’est pas suffisante, la floraison et la pollinisation seront déficientes, ce qui entraînera une baisse de la production. Cependant, les gelées tardives de début mai peuvent endommager les bourgeons, mais l’arbre peut repousser à partir d’un bourgeon situé sous la fleur. Il est également nécessaire qu’une fois que la température moyenne s’installe au-dessus de 8 °C, celle-ci soit maintenue afin que l’arbre accumule un certain nombre d’heures de chaleur, garantissant ainsi la floraison. Ce phénomène détermine donc les dates et les périodes de floraison.
Elle a une grande tolérance à la sécheresse, avec une pluviométrie minimale de 350 mm pour atteindre un niveau de production acceptable. Il ne tolère pas une humidité prolongée du sol, ce qui signifie que sa croissance optimale est obtenue dans des sols bien drainés. C’est pourquoi la méthode idéale d’irrigation est localisée, car elle évite l’engorgement. Cette opération doit être effectuée en abondance, car l’arbre réagit mieux que les petits risques à une fréquence plus élevée.
- Gestion
La méthode la plus courante de production de pistaches est la culture sèche. Cependant, il faut tenir compte du fait qu’une culture irriguée ou irriguée par déficit est nécessaire pour obtenir un rendement optimal. Une plantation est considérée comme irriguée lorsque l’eau est fournie pour couvrir les besoins de l’arbre. Dans l’irrigation déficitaire, l’apport d’eau est stratégique en fonction de la phénologie de la culture, mais toujours en quantité supérieure à 1000 m3/ha/an. L’objectif principal est d’obtenir le rendement le plus élevé avec la consommation la plus faible. Ces régimes garantissent également une plus grande ouverture des fruits, une caractéristique très appréciée sur le marché, qui a un impact direct sur la qualité visuelle du produit, affectant sa rentabilité. En bref, l’eau est un facteur important pour garantir une augmentation de la productivité et de la qualité des cultures. Le principal inconvénient est la perte de la qualité organoleptique des fruits par rapport à ceux obtenus dans une culture sèche. La prudence est également de mise, car une augmentation de l’humidité relative ambiante est associée à une augmentation du risque d’incidence des parasites, ce qui, avec des cadres de plantation étroits et un manque de taille, peut entraîner une réduction de la quantité et de la qualité de la récolte.
Par conséquent, une fois la décision prise sur le modèle à mettre en œuvre (pluvial ou irrigué), il faut établir un cadre de plantation, en fonction des caractéristiques du terrain et de la disponibilité de l’eau. C’est un point décisif, car il aura une grande influence sur différents aspects. Le cadre minimum est de 7 x 7 m, en augmentant dans les sols pluviaux peu profonds, car sinon les racines risquent de ne pas pouvoir s’étendre suffisamment dans le sol pour assurer la prise d’eau sans devoir entrer en compétition avec un autre arbre. En outre, dans les sols profonds et avec une disponibilité en eau, bien qu’a priori la chose la plus favorable puisse sembler être de regrouper les arbres, il faut considérer qu’avec le temps, les arbres deviendront plus grands et pourraient entrer en compétition pour la lumière, les nutriments et l’eau, réduisant ainsi l’efficacité photosynthétique. Pour remédier à cette situation, une taille drastique serait nécessaire, ce qui entraînerait un affaiblissement de l’arbre.
- Élagage
On peut distinguer deux types d’élagage, à savoir l’élagage de formation et l’élagage de production. La taille de formation est une taille effectuée au cours des 5 ou 8 premières années, en fonction du moment où l’arbre atteint sa pleine production. Le but de cette taille est de faire en sorte que l’arbre acquière la forme souhaitée, la forme idéale étant considérée comme un vase avec trois branches principales et une hauteur au garrot ne dépassant pas un mètre. De cette façon, on obtient de meilleurs rendements et la récolte est plus facile. A partir de ce moment, la taille de production est effectuée en hiver, chaque année productive. Son objectif est d’obtenir l’aération et la luminosité à l’intérieur du vase, tout en maintenant les niveaux de production.
- Ravageurs et maladies
Punaise verte (Nezara viridula) : espèce d’insecte hémiptère, qui dégage une odeur irritante intense lorsqu’elle se sent menacée ou qu’on lui marche dessus. En raison de ses caractéristiques physiques, il est difficile à détecter. Cependant, elle représente un grand danger, car en plus de déprécier la qualité des fruits, qui se flétrissent ou présentent des déformations et des taches sombres, dans les cas où elle n’est pas contrôlée à temps, elle peut provoquer une perte totale de la récolte. Il provoque principalement des pointillés sur les feuilles qui, une fois déployées, ont tendance à se briser relativement facilement dans les zones pointillées. Les œufs sont pondus sur la face inférieure de la feuille en forme d’hexagone et de nid d’abeille.
Plodia interpunctella (Plodia interpunctella) : une espèce de lépidoptère, également connue sous le nom de papillon de nuit de la noix baguée. Ce papillon peut causer des pertes directes, ainsi que des coûts économiques indirects, en raison des pertes de qualité et des plaintes des consommateurs. Elle touche les produits stockés et emballés, pour lesquels il est nécessaire de maintenir le lieu de stockage propre, en insistant particulièrement sur les fissures et les coins. Les denrées alimentaires et les emballages doivent également être contrôlés pour détecter si d’autres denrées alimentaires ont été compromises et il est essentiel de les retirer. Les dégâts sont dus à l’entrée des larves dans les fruits, où elles creusent des galeries, provoquant une contamination par la présence d’exuvies et de restes de soie.
Psylle du pistachier (Agonoscena pistaciae) : une espèce d’hyménoptère dont les adultes sont de couleur jaune foncé, avec parfois des taches noires. Elle est relativement facile à détecter visuellement, car des masses cotonneuses caractéristiques se forment sur les feuilles. Sur la face inférieure des feuilles, il est également possible de voir les nymphes de couleur jaune-orange, où elles se nourrissent. Tant les adultes que les stades plus immatures basent leur alimentation sur l’ingestion de la sève de la plante, ce qui déclenche une réduction de la croissance, provoquant également une chute de la pousse, ce qui entraîne la défoliation, la chute des fruits et, par conséquent, une réduction considérable du rendement de la culture.
Clitra ou coléoptère (Labidostomis lusitanica) : appartenant au genre des coléoptères, petit coléoptère, d’aspect compact, présentant un dimorphisme sexuel au sein d’une même espèce, de sorte que les mâles sont plus grands que les femelles. La tête et le pronotum sont noirs et les élytres sont d’une couleur orange frappante avec un point noir au début, ce qui les rend facilement reconnaissables. Ils se nourrissent au printemps des feuilles tendres, principalement des nouvelles pousses, ce qui peut entraîner la défoliation de l’arbre. Ils pondent leurs œufs près des nids de fourmis, où ils se déplacent après l’éclosion, colonisant le nid et se nourrissant des déchets des fourmis.
Fourmi à queue marron (Vesperus xatarti) : coléoptère dont la vie adulte est très courte et se termine après l’accouplement et la ponte. Les œufs sont facilement reconnaissables, car ils sont disposés en tache blanchâtre, fixée par une substance mucilagineuse qui durcit, servant ainsi de protection. Les larves sortent de l’écorce des arbres et parcourent de courtes distances pour atteindre le sol, où elles s’enterrent à la recherche des racines, dont elles se nourrissent. Il en résulte des dommages qui limitent la capacité de la culture à assimiler les nutriments. Si l’arbre est très jeune, il peut être complètement détruit en peu de temps. Chez les arbres plus matures, les symptômes qui apparaissent peuvent être confondus avec ceux d’autres problèmes, car leur vigueur diminue, ils sont affaiblis et la récolte est beaucoup plus petite qu’elle ne devrait l’être, avec des fruits de taille réduite.
Cochenille farineuse (Saessetia oleae) : insecte homoptère dont la forme la plus connue est la femelle adulte de couleur brun foncé qui, sous sa carapace, protège ses œufs, lesquels sont pondus sans qu’il soit nécessaire de les féconder. Compte tenu de la rareté des mâles et de la caractéristique susmentionnée, on peut dire que la reproduction de cette espèce de cochenille est parthénogénétique. Dès l’apparition des premières larves, qui sont d’abord mobiles, jusqu’à ce qu’elles se fixent définitivement, elles se déplacent vers les nouvelles pousses, généralement sur la face supérieure et plus particulièrement sur la nervure centrale. L’une des principales causes de dommages est due à l’excrétion de miellat, qui favorise l’établissement de ce que l’on appelle le champignon de la moisissure noire, qui forme une couche noire sur les feuilles, semblable à de la suie, qui empêche l’incidence de la lumière du soleil, réduisant ainsi l’activité photosynthétique. Ils provoquent également un affaiblissement général dû à la succion de la sève.
Botryosphaeria dothidea (Botryosphaeria dothidea): maladie du pistachier, nommée d’après le champignon qui la provoque. Elle se caractérise par la formation d’une série de plaies, qui apparaissent comme des lésions déprimées sur l’écorce, sans changement évident de couleur par rapport à l’écorce saine. C’est pourquoi on l’appelle aussi chancre, qui peut s’étendre sur toute la longueur d’une branche. Suite à l’apparition de ces lésions, les feuilles se flétrissent progressivement, c’est-à-dire qu’elles perdent leur turgescence, jusqu’à devenir pliées et collées les unes aux autres, restant ainsi attachées à la branche pendant une longue période, jusqu’à ce qu’elles finissent par tomber. En ce qui concerne l’évolution des symptômes sur la branche affectée, on peut d’abord observer une nécrose de l’apex et un flétrissement des jeunes feuilles. Par la suite, ces symptômes se développent et s’aggravent de l’apex à l’extrémité la plus proximale de la branche. Cette progression est connue sous le nom de dépérissement et peut apparaître sur une seule branche ou sur plusieurs branches d’un même arbre.
Verticillium dahliae (Verticillium dahliae) : maladie provoquée par l’action du champignon pathogène qui lui donne son nom, qui entraîne une décoloration et un enroulement des feuilles. Elle peut même entraîner la mort de l’arbre, car ses branches se dessèchent progressivement. La transmission peut se faire entre des arbres de la même espèce ou par contagion à travers un hôte, comme les espèces adventices et d’autres espèces cultivées dans des zones voisines. Le champignon infecte l’arbre par les racines, en profitant des lésions à la surface de l’arbre causées par les travaux effectués par l’agriculteur ou par l’action d’autres êtres vivants, comme les insectes ou les nématodes. Une fois qu’il a atteint l’intérieur, le mycélium du champignon se propage relativement rapidement dans le système vasculaire, en provoquant une réaction aux substances visqueuses produites par l’agent pathogène, qui obstruent les vaisseaux conducteurs.
Alternaria, alternariose ou mildiou (Alternaria alternata) : provoqué par un champignon pathogène opportuniste, qui profite de tout type d’ouverture disponible pour accéder à l’hôte, comme les plaies ou celles de type naturel, comme les lenticelles, structures spécialisées, de forme circulaire et allongée, qui assurent l’entrée de l’oxygène, c’est-à-dire les échanges gazeux. Les symptômes commencent à apparaître sur les feuilles basales, puis progressent vers les strates supérieures. Au début, les feuilles prennent une teinte jaunâtre à l’extrémité, qui se développe progressivement le long des bords jusqu’au pétiole. Ensuite, une série de taches de taille variable apparaissent sur les feuilles, avec une bordure violette et un centre blanchâtre ou brunâtre. Au centre de la lésion, il peut y avoir des ruptures dans le tissu nécrotique.
Rouille du pistachier (Pileolaria terebinthi) : le champignon qui produit cette maladie accomplit son cycle complet dans les arbres, plus précisément dans tous ceux qui appartiennent au genre Pistacia. Elle est transmise par voie aérienne au moyen de basidiospores, qui sont des spores reproductives. Pendant l’hiver, les structures d’hivernage peuvent être trouvées sur les feuilles tombées au sol, se développant à nouveau dès que les températures dépassent 15°C. Les symptômes commencent par l’apparition d’une cloque sur les feuilles. Les symptômes commencent par l’apparition d’une série de taches nécrotiques sur les feuilles, caractérisées par une couleur brunâtre et entourées d’une fine marge jaunâtre. Occasionnellement, une perforation du limbe des feuilles peut se produire. Au fil du temps, les taches deviennent plus foncées et poudreuses et finissent par s’étendre sur toute la surface, jusqu’à devenir une masse brun foncé de tissu nécrotique. En cas d’infection sévère, la défoliation de l’arbre peut être préoccupante. On peut également trouver des pustules sur les fruits.
Septoria (Septoria pistaciae, Septoria pistaciarum et Septoria pistacina) : cette maladie, causée par l’action de plusieurs champignons ascomycètes, a été trouvée dans tous les pays producteurs de pistaches. Comme dans les cas précédents, la symptomatologie consiste en l’apparition et le développement de taches nécrotiques irrégulières. Cependant, dans cette pathologie, les taches, bien qu’elles puissent être très nombreuses sur une même feuille, restent petites et isolées les unes des autres. Les arbres qui ne sont pas traités subiront une défoliation précoce et seront affaiblis l’année suivante. Le champignon passe l’hiver sur les feuilles mortes qui ont été infectées la saison précédente. Les ascospores, au moment où elles sont mûres et prêtes à être libérées, sont libérées pendant et après les pluies.